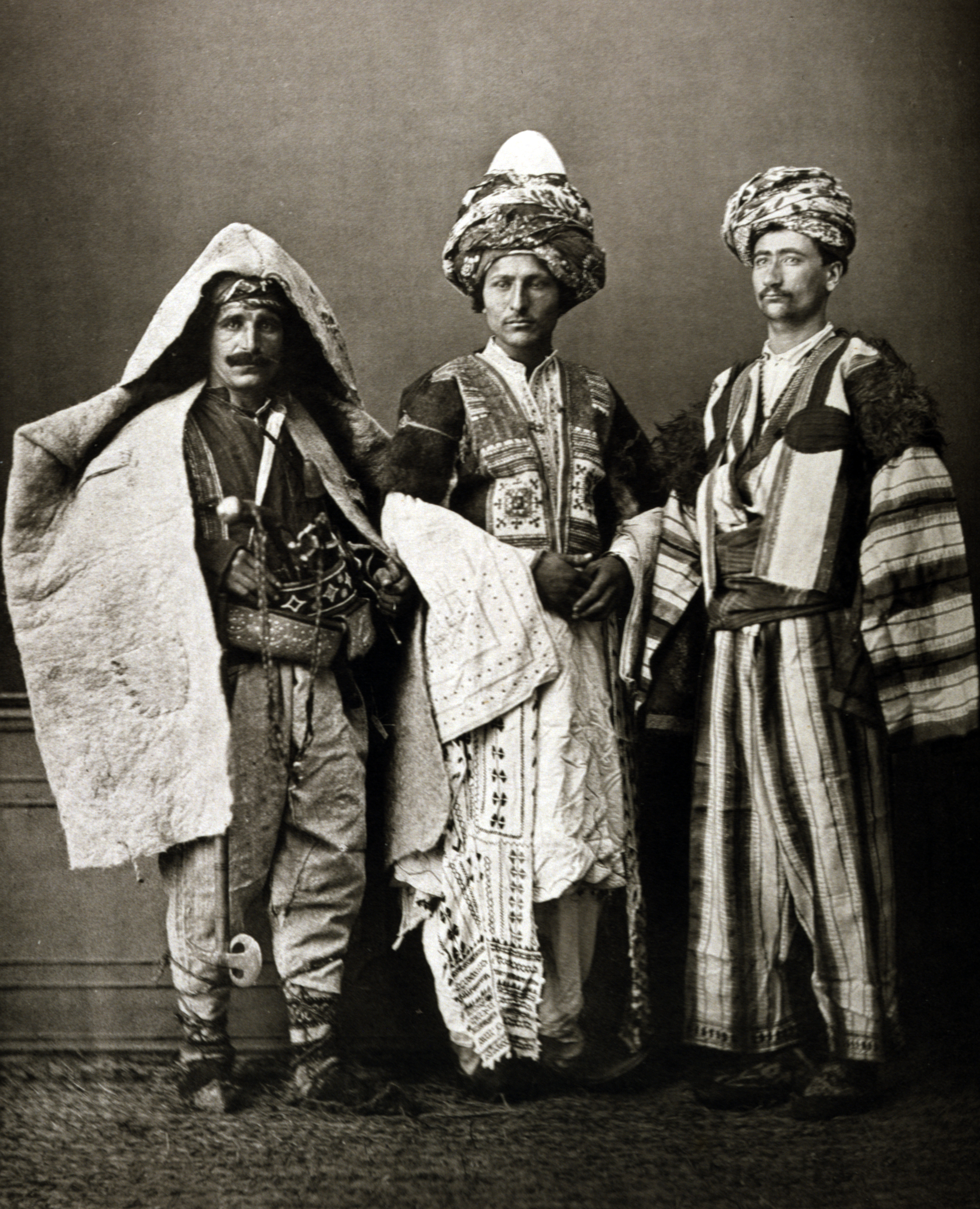Le 20e siècle : nouvelles frontières, nouveaux défis
Après la Première Guerre mondiale et l’effondrement de l’Empire ottoman, les Kurdes ont eu l’occasion de créer leur propre État. Le traité de Sèvres de 1920 prévoyait la possibilité de créer un État kurde sur le territoire de l’ancien Empire ottoman. Malheureusement, ce traité n’a pas été mis en œuvre et a été remplacé par le traité de Lausanne (1923), qui a établi de nouvelles frontières au Moyen-Orient sans inclure d’État kurde. En conséquence, les Kurdes ont été divisés entre la Turquie, l’Iran, l’Irak et la Syrie, où ils se trouvent encore aujourd’hui.

Pour les Kurdes, cette période a marqué le début d’une lutte difficile pour la reconnaissance et la préservation de leur propre identité dans quatre pays différents. Les tentatives de conquête de l’autonomie ou de l’indépendance se sont heurtées à une forte répression, notamment en Turquie et en Iran, où les autorités ont mené une politique d’assimilation et interdit l’utilisation de la langue kurde et la manifestation de la spécificité culturelle.